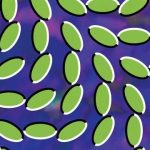Curieux cette sensation d’avoir attendu avec un espoir monumental le plus beau film de Terrence Malick, de pressentir avec bonheur son sacre cannois et d’être poussé par des forces bien moins sublimes à écrire cette critique, qui ressemble à quelque chose d’impertinent et de résiduel comparé au cinéma de Malick, et dont la seule vertu pourrait être de revenir sur un film étrange où l’on parle d’œuf, de naissance, et surtout, du mal.
Curieux cette sensation d’avoir attendu avec un espoir monumental le plus beau film de Terrence Malick, de pressentir avec bonheur son sacre cannois et d’être poussé par des forces bien moins sublimes à écrire cette critique, qui ressemble à quelque chose d’impertinent et de résiduel comparé au cinéma de Malick, et dont la seule vertu pourrait être de revenir sur un film étrange où l’on parle d’œuf, de naissance, et surtout, du mal.
Le premier quart du film ressemble à ce qu’on pourrait appeler, après le football total, du cinéma total. Un chant porté haut, très haut : intimité, chuchotements, emprise du son, magnétisme de la lumière, grâce, bonheur total, souffrance totale. C’est purement religieux et, personnellement, je jubile. Certes, déjà, il y a Sean Penn un peu hagard, certains plans tellement symétrisés qu’ils ont des allures de publicité pour parfumeurs (et il y a parfois du cinéma dans la publicité, il faudrait en reparler), et puis déjà des incompréhensions, des vides ou des ellipses dont on peut craindre qu’elles cachent une pauvreté dans le traitement du sujet. Mais on est patient. C’est un requiem pour un enfant mort, c’est la question du mal aux alentours, c’est sa résolution par la cruauté et par la nature, qui n’a d’autre principe qu’elle-même. C’est très beau. On continue.
Ce n’est pas le deuxième quart qui fâche. Dans un sens, on a envie de l’aimer ce traitement direct du big bang. Et cette rencontre entre deux dinosaures semble finalement appartenir à la même veine : nous sommes tout-petits, entourés de questions, submergés par le métaphysique, nous sommes des créatures des dieux, nous ne savons pas qui nous sommes. Non, ce n’est pas ça qui fâche, c’est la seconde moitié du film. Et plus elle avance cette moitié, plus elle se construit comme une déception. Tout y est redite. On voulait du magma, on a des enchevêtrements d’images. On est en mode random.
C’est une des caractéristiques de Malick de faire se succéder de nombreux plans en mode feuilleté, qui tous disent la même chose, mais dont chacun dit finalement peu. C’est un invariant chez lui, comme une rengaine, ou plutôt un de ses traits de constitution. Dans Le Nouveau Monde, c’était une succession de plans d’arbres qui venaient clore la symphonie, parce que, comment la clore, comment choisir parmi cette luxuriance ? Cet amas avait quelque chose d’informe et donnait l’impression étrange de quelque chose d’inachevé, une impossibilité à dire plus qui se répercutait dans les ruptures entre ces plans de trop. Ici, c’est par exemple une reconstitution du paradis. Pas grave que celui-ci soit une plage où les gens se recroisent et s’aiment à nouveau. Mais on attendait une immensité, une grande secousse. On se retrouve avec une série de plans toujours plus courts, des acteurs qui semblent gênés, quelque chose de mal filmé. Incompréhensible. Ce n’est plus Malick qui découvre, qui s’extasie. Ce n’est plus un crescendo dantesque, étrange et brumeux comme les prémisses de la bataille dans La Ligne Rouge. Le film n’est donc pas très bon, en partie raté, ce qui équivaut à dire, ici, qu’il l’est totalement. Pas très grave peut-être. Monstre Malick.bub
Marc Urumi
bub
———
The Tree of Life de Terrence Malick (Etats-Unis ; 2h18)
Date de sortie : 18 mai 2011
bub